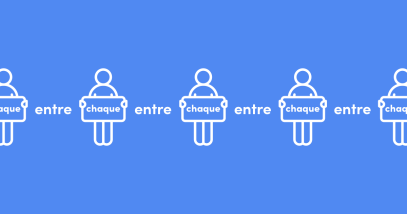Pour bien commencer la septaine

Les œufs se vendent généralement à la douzaine. On peut aussi les vendre à la demi-douzaine ou en paquet de dix-huit. Une question se pose cependant pour ces deux derniers ensembles : pourquoi ne se vendent-ils pas plutôt à la sixaine ou à la dix-huitaine? Ce billet propose un petit voyage temporel pour élucider partiellement ce mystère.
Principaux noms collectifs numéraux
Les noms collectifs numéraux sont des mots dérivés de numéraux (dix, douze, vingt, cent, etc.) qui permettent d’indiquer la quantité d’objets ou de personnes représentés par un nom complément. Ils sont généralement utilisés lorsque la quantité en question est approximative ou incertaine :
J’ai invité une douzaine d’amis.
C’est-à-dire plus ou moins douze amis.
Une centaine de spectateurs sont venus.
C’est-à-dire un nombre de spectateurs qu’on estime à près de cent.
Ils peuvent aussi désigner une quantité bien précise et sont alors synonymes du déterminant numéral correspondant. C’est notamment le cas dans l’affichage commercial :
La douzaine d’œufs est vendue à rabais.
C’est-à-dire le paquet de douze œufs.
Il est permis d’utiliser ce type de collectif dans tout contexte pour référer à un nombre précis, en supposant que cela formerait alors une unité en soi, mais cet emploi introduit nécessairement une ambigüité :
J’ai loué un chalet avec ma dizaine d’amis.
Faut-il comprendre « mes dix amis » ou « environ dix de mes amis »?
Un inventaire limité en français
Les collectifs numéraux largement reconnus en français appartiennent à une liste plutôt courte, formée entre autres de dizaine, douzaine, demi-douzaine, quinzaine et plus rarement huitaine. Ils sont cautionnés par l’usage, pour des raisons pratiques ou historiques, et sont consignés dans la plupart des dictionnaires. On retient notamment la popularité de douzaine, dont la pérennité dans la langue commerciale s’explique entre autres par sa divisibilité par deux, trois, quatre et six.
Ceux qui sont dérivés des numéraux cardinaux simples (non composés) exprimant des multiples de dix sont aussi parfaitement naturels en français (vingtaine, trentaine, centaine, millier, etc.), et dénotent de grandes quantités bien souvent approximatives.
De la justesse à l’approximation
La lecture des sources lexicographiques qui ont recensé ces termes à partir du xviie siècle permet de dégager une évolution progressive de leur sens strictement arithmétique à un emploi souvent approximatif.
Le Dictionnaire universel d’Antoine Furetière (1690) indique que, « en discours commun », dizaine peut être utilisé au lieu du déterminant numéral dix. Il ne mentionne cependant pas qu’il peut être employé pour désigner une quantité approximative de choses qui avoisinerait dix. On trouve le même traitement dans le Dictionnaire de Trévoux (1738-1742) et le Dictionnaire de l’Académie française, de sa première (1694) à sa huitième édition (1935).
Le Dictionnaire de la langue française d’Émile Littré, publié à partir de 1863, contient la nuance de sens suivante, qui apparait dans tous les dictionnaires modernes :
Une dizaine se dit quelquefois pour un nombre indéfini qui approche de dix1.
On observe une évolution plus rapide pour douzaine qui, dans le Trévoux, contient déjà une telle acception :
[Douzaine] se prend souvent dans le discours familier et dans l’usage ordinaire pour un nombre indéterminé, et non pas pour le nombre juste et précis de douze2.
L’Académie française admet ce même sens, qu’on dit aussi familier, dans la cinquième édition de son dictionnaire, publiée en 1798.
Quinzaine n’est connu des plus vieux dictionnaires qu’au sens d’une série de quinze jours, soit une période de deux semaines, en comptant le premier jour de la suivante. C’est seulement à partir du xixe siècle qu’on lui donne un sens par extension pour désigner un ensemble quelconque de quinze éléments. L’histoire est la même pour la huitaine, mot cependant moins usité de nos jours, et auquel on préfère même parfois demi-quinzaine.
Ces noms collectifs inusités
L’inventaire de termes présentés jusqu’ici ne contient que ceux consignés dans la majorité des dictionnaires de langue. En principe, le même procédé de dérivation peut s’appliquer aux autres nombres cardinaux pour former ce genre de noms collectifs, dont les attestations varient grandement selon l’époque, la région linguistique ou le registre langagier.
On trouve par exemple dans le Littré les collectifs numéraux de la sixaine à la seizaine. Une sixaine y est définie comme une collection de six objets (l’équivalent d’une demi-douzaine), une neuvaine, comme une collection de neuf, une treizaine, comme une collection de treize, et ainsi de suite.
Le mot treizaine (ou, au masculin, treizain) connait par ailleurs un emploi contemporain plus marqué dans certaines régions linguistiques. Il est associé à une pratique marchande qui consiste à complémenter la douzaine d’un produit par une unité résiduelle. Acheter à la treizaine revient donc à acheter treize à la douzaine, comme dit l’expression. Cette treizaine est assimilable à la long dozen (littéralement douzaine longue) en anglais, également appelée baker’s dozen (littéralement douzaine du boulanger).
Le Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes de Frédéric Godefroy rapporte une occurrence de 1223 du mot cinquain et une de 1387 du mot quatraine, défini comme un « assemblage de quatre objets3 ».
Le collectif en -ain(e) dérivé de trois est difficile à débusquer dans le moindre ouvrage lexicographique, et ses occurrences sont frileuses dans la littérature. Un exemple vient de l’auteur belge Camille Lemonnier, qui écrit en 1886 dans Happe-chair : « […] mais dans ce prix figurait l’encavement d’une futaille de vin, d’un baril de genièvre et d’une troizaine de tonnes de bière4 ».
Deuzaine, qui aurait lui aussi plutôt appartenu à la langue familière, est signalé dans un dictionnaire d’expressions impropres de la Lorraine de 1807 :
Combien en voulez-vous ? J’en prendrai une deuzaine5.
On y recommande d’utiliser plutôt « J’en prendrai une couple ».
Compétition sévère pour les plus petits numéraux
Ces sources ne mentionnent pas que ces collectifs auraient été employés à l’époque pour référer à des ensembles approximatifs d’entités. On peut supposer que cette nuance de sens dépend d’une implantation plus robuste dans l’usage. Les emplois contemporains de termes comme neuvaine et onzaine, qui relèvent souvent d’un effort de créativité lexicale, contrastent paradoxalement avec les ensembles flous bien établis comme dizaine et douzaine, et supposent conséquemment une plus grande précision.
La rareté des collectifs dérivés des plus petits nombres cardinaux peut s’expliquer en partie par l’existence de noms collectifs équivalents qui s’utilisent dans certains contextes et qui sont plus ou moins courants en français.
| collectif | termes similaires | |
|---|---|---|
| deuzaine | paire, couple, duo, dyade | |
| troizaine | triplet, trio, triade | |
| quatraine | quatuor, tétrade | |
| cinquaine | quintuor, quintette |
À l’autre extrémité, on rencontre rarement les collectifs dérivés des numéraux au-delà de seize (dix-septaine, vingt-troizaine, soixante-douzaine, etc.) qui n’expriment pas des multiples de dix. Pour leur lourdeur ou pour la même raison paradoxale évoquée plus haut, on se contentera plutôt d’utiliser le nombre correspondant. Exception notable aux termes tels que la vingt-cinquaine ou la quarante-cinquaine, qui réfèrent un peu pointilleusement à des périodes de la vie.
On devinera par la nature du nombre un que le besoin d’en dériver un nom collectif ne s’est pas fait sentir et que unaine ne complète ainsi pas cette série.
Ce qu’il reste des collectifs numéraux
Si la plupart des mots de cette série n’ont pas été retenus dans l’usage pour désigner des objets quelconques, plusieurs de leurs emplois historiques perdurent avec un complément sous-entendu bien précis.
D’emblée, on peut penser à la série de mots tels que quatrain, sixain/sizain, douzain, seizain (de vers), etc., soit des strophes de quatre, six, douze et seize vers, respectivement.
Une sizaine est un groupe de plus ou moins six jeunes scouts. Dans l’Église catholique, une neuvaine désigne une série de prières effectuées sur neuf jours.
Sur le modèle de quarantaine, les termes septaine et quatorzaine se sont popularisés en France lors de la pandémie de COVID-19 pour désigner des périodes respectives de sept et quatorze jours d’isolation.
D’autres de ces emplois sont recensés çà et là parmi les dizaines de dictionnaires modernes. Il suffit d’y mettre le nez, par curiosité, pour les dénicher.
-
Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, t. 2, Paris, Hachette, 1873-1874, p. 1203. ↩
-
Dictionnaire universel françois et latin, vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux : contenant la signification et la définition des mots de l’une et de l’autre langue, Nancy, 1738-1742, p. 453. ↩
-
Frédéric Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du ixe au xve siècle, t. 6, Paris, Émile Bouillon, 1889, p. 490. ↩
-
Camille Lemonnier, Happe-chair, Paris, Louis-Michaud, 1886, p. 109. ↩
-
Jean-François Michel, Dictionnaire des expressions vicieuses usitées dans un grand nombre de départemens, et notamment, dans la ci-devant Province de Lorraine, Nancy, 1807, p. 70. ↩